
Voici comme j’annonçais la projection du film d’Alain & Wasthie Comte sur Igor Minarik et Eva Minarikova, et la conférence sub-séquente : Peut-on réinventer le collage en se passant de colle ?
Les drogués du copié-collé que vous êtes ont certainement quelques «bien sûr» dans leur rubrique «réponse immédiate», et – pour une fois – vous avez raison : l’ordinateur a mis le collage sans colle à portée de tous. Et si vous êtes un peu colletivés, vous allez sans doute me rappeler ce que disait Max Ernst : ce n’est pas la colle qui fait le collage.
Bon, d’accord, il n’est pas indispensable de sniffer ce produit adhésif pour ressentir les effets euphorisants du grand brassage d’images collagiste. Seulement … Max Ernst voulait attirer l’attention sur le rôle que joue, dans cette activité qu’il avait inventée, un facteur bizarre, fantômatique et nettement moins répandu que le bon sens selon Descartes, qu’on appelait autrefois «l’esprit» … et puis, comme tout ce qui est facile, le collage informatique est bien moins beau que ce qui ne l’est pas, comme
le collage avec colle – dont nous avons vu de beaux exemples la dernière fois avec Otis Laubert -,
la peinture – à l’huile ou à l’eau –
ou la tapisserie.
Si vous voulez découvrir de beaux exemples anté-compiouteuriens de cette manière de créer des merveilles, venez voir le film qu’Alain & Wasthie Comte ont consacré à Igor Minárik et Eva Mináriková, qui sera projeté à l’auditorium de la médiathèque de Châteauroux ce jeudi, le 2 avril (de 2015, la machine à collager dans le temps n’est pas encore au point), avec quelques commentaires franchement partiaux mais parfaitement objectifs, comme d’habitude.

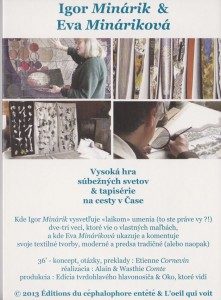
et voici ce que j’avais l’intention de dire (selon le principe auquel je me suis toujours tenu : quand il y en a pour quatre heures, il y en a pour deux), après projection du film (que vous pouvez voir surhttps://vimeo.com/124121224, où en commandant le magnifique livret – DVD Cf http://nouvelles-hybrides.fr/wordpress/?p=7861)
Est-ce qu’un film peut faire ressentir ce que ces œuvres ont d’extrêmement admirable et étonnant ? Comme on voit les artistes, on peut avoir l’impression que ça va de soi …
Un peintre et une tisseuse, nés respectivement en 1948 et 1945, qui ont commencé à créer des œuvres originales fin des années 60 (pendant le « Printemps de Prague ») et années 70 (première décennie de « normalisation »), et n’ont pas été empêchés de créer par le contexte très hostile à tout art « expérimental » (immédiatement qualifié de « formaliste », importé de « l’Ouest » et donc interdit d’exposition). Simplement, ils – surtout lui, les exigences du « Réalisme socialiste » s’appliquaient mal à la tapisserie – pendant une vingtaine d’années, n’ont pas pu montrer ce qu’ils faisaient à d’autres regardeurs que quelques amis sûrs.
L’un comme l’autre ont cherché des possibilités nouvelles de la peinture et de la tapisserie = de médiums artistiques considérés en général comme dépassés, incapables d’exprimer notre époque, trop lents pour être en phase avec elle (et ce n’est pas faux, mais cela ne veut pas dire que les œuvres réalisés avec ces médiums ne disent rien, et a priori ce sont des médiums assez lents pour être en phase avec ce qui dans la vie est essentiellement lent), et ils en ont trouvé en veux-tu en voilà !
Dans le cas d’Igor comme dans celui d’Eva, c’est l’abondance de créations à chaque fois différentes qui saute aux yeux : rien de mécanique ni chez l’un ni chez l’autre. Rien non plus de facile : on est toujours dans du fait-main, patiemment, avec de nombreux problèmes délicats de réalisation à résoudre en chemin.
Victime sans doute moi-même du préjugé contre la lenteur que je dénonce maintenant, j’ai découvert sur le tard la valeur de ce que faisait Eva – le mélange d’inventivité et de lenteur dans les peintures d’Igor m’a par contre tout de suite ébloui, et paru compréhensible. Mais si on admet que faire des tapisseries peut être une continuation de la peinture par d’autres moyens, on doit reconnaître qu’elle a peint avec de la laine, du lin, du chanvre, … en associant des éléments illusionnistes, abstraits et réels, en faisant des installations d’objets tissés, avec des tapisseries en relief, à regarder des deux côtés, trouées, en constituant des recueils d’échantillons de broderie, des syllabaires, des abécédaires, des herbiers … elle a considérablement contribué à libérer la tapisserie du décorativisme où elle était enfermée, et ses œuvres tiendraient sans problème dans des expositions internationales. Comme je n’ai rien écrit sur elle d’un peu consistant, je me contenterai de vous lire les repères biographiques que j’ai rédigés pour le livret d’accompagnement du DVD.
Eva Mináriková
née Cisárová le 16 décembre 1945 à Cífer (Nord-Ouest de Bratislava). père maréchal-ferrand et serrurier d’art – 1961–1965 : École secondaire d’art industriel à Brno, section dessin textile- 1968–1972 : École Supérieure d’Arts Plastiques de Bratislava, section « Création libre et tissage »
1973-1974 : sa première oeuvre d’Opus repose déjà sur le dialogue entre modernité et tradition : elle y insère une citation d’un fragment de tapisserie gothique, évoquant la geste d’Alexandre le grand, dans un contexte moderne, quasi-abstrait et beaucoup plus matériel (XVème & XXème siècle, 225.300 cm) ; elle fera dans les années 70 plusieurs très grandes tapisseries de principe analogue (en 1981-82, par exemple, Confrontation avec une tapisserie de Bruxelles, 184. 270.10 cm, combinaison de corde, laine, chanvre, filin, où elle cite un détail d’une tapisserie renaissance sur la construction de l’arche de Noé, et prolonge les cordes représentées par des cordages réels)
pendant les années 80, elle crée des « peintures-tapisseries », qui sont comme des aquarelles de Klee considérablement agrandies (Bandeau, 1983-1984, multiplication par 10 d’un bandeau traditionnel de Terchova, fait 2 m sur 3) et enrichies d’une dimension spatiale et matérielle toute nouvelle, ou des « tapisseries transparentes », sortes de filets à cordes colorées épaisses et à plus ou moins larges mailles, que l’on peut voir des deux côtés.
en 1989, gagne un concours et est nommée professeur aux « Beaux Arts » de Bratislava. Elle y ouvre un atelier de Création textile (en 1995, elle y adjoindra une section de Restauration de textiles historiques, dans le cadre de laquelle elle explorera l’histoire des tissus et des technologies de tissage, ce qui donnera lieu à de nombreuses découvertes, créations – il s’agit toujours d’enrichir le répertoire moderne par les possibilités traditionnelles – et publications)
dans les années 90, fait des « objets textiles », un genre d’oeuvre essentiellement poétique, formellement situé entre tapisserie, peinture, sculpture et installation, qui permet d’effectuer tout un travail de mémoire et de recollection de broderies, d’écritures ou de compositions anciennes : « sculptures » tissées, qui évoquent des cerfs-volants ; grands « Mementos calligraphiques », de signes-noeuds d’étoupe, qui peuvent être regardés des deux côtés ; recueils de modèles brodés d’initiales, de lettres ou de chiffres (Syllabaire ; Abécédaire ; Nuancier d’écritures ; Livre de l’église du village de Cziffer ; Herbier = plusieurs « livres de toile », souvent de très grand format) – fait également des objets miniatures de fil de fer inspirés librement de formes de donjon, cloche, paume, …
2010 : elle reçoit la consécration d’une monographie très richement illustrée (texte d’Eugénia Sikorová, Éditions Michala Vaška)
Eva Cisárová-Mináriková a participé à des dizaines d’expositions collectives, comme représentante de la création textile en Tchécoslovaquie ou en Slovaquie, et avait eu, en 2010, 13 expositions individuelles.
Pour ce qui concerne Igor, j’ai eu l’occasion d’écrire sur son « travail » dès les années 90, où j’étais le théoricien du groupe Avance-Retard, et cela n’a pas dû lui déplaire, car il m’a demandé en 2007 d’écrire le texte d’une monographie qui devait lui être consacrée (Cf http://nouvelles-hybrides.fr/wordpress/?p=3911). Cela a donné un lexique de 73 entrées qui vont d’Abstraction et Alchimie à Vide et Vie et opinions de Tristram Shandy, en passant par Surnaturalisme, Pataphysique, Nature, Musicalité, Laubert (Otis), Fila (Rudo), Fischer (Daniel), Contemplatif ou Big Bang Dong.
Je ne saurais mieux faire que de vous en lire quelques articles, choisis en fonction de ce thème du collage, sous le chapeau magique duquel j’ai mis cette soirée, et en fonction de ce que je suppose que vous connaissez.
C H A OS M O SE
ou
la modernisation de l’arc en ciel
selon Igor Minárik
Dieu est dans les détails
Min Hu Skull, miniaturiste
L’arbre cache la forêt
Sagesse traditionnelle
La forêt cache l’arbre ;
une forêt cache les autres forêts ;
une forêt cache la diversité des forêts ;
des arbres tous différents ne font pas une forêt ;
les arbres cachent tout ce qui n’est pas arbre ;
les forêts cachent tout ce qui n’est pas forêt ;
l’absence de forêts cache leur diminution, leur disparition ;
les restes de forêts cachent la forêt des origines, qui était partout ;
le mot « forêt » cache les arbres de la forêt ;
le mot « vert » cache l’infinie diversité des couleurs de la forêt ;
chaque arbre est une forêt ;
si le mot « arbre » s’écrivait « forêt », il ne cacherait pas les forêts que sont les arbres ;
toute forêt est un labyrinthe (dès qu’on est dans la forêt, on s’y perd)
René Garmitte : Compléments à la Sagesse traditionnelle
En fin de compte, le but d’un tableau n’est-il pas de nous rendre heureux ?
Paul Klee
Collage : comme Max Ernst l’avait déjà dit, ce n’est pas la colle qui fait le collage, et les tableaux d’Igor Minárik, bien que certains seulement recourent à l’utilisation de colle (qui doit alors souvent être une colle très puissante, car il n’hésite pas à fixer des éléments très lourds sur ses supports) sont des collages. Des collages d’éléments « abstraits », non illusionnistes, échappant donc aux modèles impérialistes légués par Max Ernst ou Jiří Kolář, mais comme les leurs d’esprit dada, c’est-à-dire … hippocampe du chaos ne serait peut-être pas une si mauvaise explication. Le seul grand peintre qui – à ma connaissance – l’a précédé immédiatement dans cette manière de créer avec des éléments non figuratifs, est Jean Dubuffet, avec en particulier ses « texturologies », et lui-aussi était un crypto-collagiste d’esprit dada.
Dubuffet (Jean) : a fait un éloge vibrant de ce que fait Igor Minárik en croyant écrire une préface pour la première pièce de Valère Novarina. Jugez-en : « /…/ la littérature (je veux dire celle qui sévit) je l’ai en aversion à un point sans aucun doute exceptionnel. Les romans, les colloques et séminaires, les fines psychologies, le bon ton, le bel écrire, j’y suis allergique à un degré qui n’est pas croyable. Je suis avide mangeur d’éclosions crues et je ne me vois offrir que cuit et recuit, précuit, surbouilli, dragées cent fois sucées qui me laissent sur ma faim, je souffre de faim, c’est à peine si chaque trois ou quatre ans je trouve un petit repas à faire. Sur d’autres terrains celui de la peinture par exemple – c’est mon domaine, allez-vous dire, et la pensée vous viendra même, je le crains, que je ferais mieux de m’y cantonner, mais vous aurez là tort – on rencontre assez abondamment, hors les ressassements culturels, des inventions libérées et libératrices ouvrant à la pensée des vues nouvelles. Mais sur le terrain de la littérature, où les esprits sont si bien endoctrinés, la vraie invention ne montre pas souvent son nez. Bonne raison pour l’applaudir très fort quand il arrive qu’elle le fait, comme en voici justement un cas comblant. Je dis comblant parce que les inventions apparaissent souvent créatives seulement par un côté, tandis qu’elles restent par d’autres empêtrées dans d’insipides normes, mais celle-ci non. Elle est totalement créative dans tous ses ressorts, depuis son assiette même et jusqu’en ses détails les plus menus. L’étonnement se renouvelle à chaque page, à chaque ligne. /…/ »
Novarina (Valère) : si l’on cherche des œuvres comparables à ce que fait Igor Minárik dans d’autres formes d’art (pour la musique, Cf *Musicalité), on ne trouve presque rien, et cela semble à la réflexion logique, car chaque art a ses contraintes et l’ « art » moderne semble être le seul à autoriser une telle densité de pure création : les diverses formes de poésie, le théâtre, le roman, la nouvelle, le cinéma comportent nécessairement une large part d’imitation. Toutefois, les amples poèmes « simultanéistes » d’Apollinaire, Cendrars, T.S Eliot, Ezra Pound, Joyce ou Nezval reposent eux aussi sur la juxtaposition d’innombrables éléments hétéroclites (et ont eux aussi le pouvoir d’engendrer un espace poétique dont l’immensité semble au diapason de celle de l’univers). Plus proches encore : les poèmes dans lesquels les mots sont remplacés par les sons qui les constituent mais sont eux mêmes dépourvus de signification conventionnelle, comme ceux des « transmentalistes » russes (Chlebnikhov, Kroutchenich, Zdanevitch), les « optophonétismes » d’Hausmann, le fameux Karawane d’Hugo Ball, la non moins fameuse Ursonate de Schwitters ou, trente ans plus tard, la « poésie sonore » de Isou, Dufrêne, Wolman, Chopin, Heidsiek, Novák, … (la « poésie concrète » des années 50-60, dans laquelle le jeu poétique est déplacé vers les micro-composantes de l’écriture, et qui est souvent le fait des mêmes auteurs que la « poésie sonore » – Jiŕí Kolář et Ladislav Novák, de Trebíč, sont les plus connus, mais il y a eu, avec Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Zdenek Barborka, Ladislav Nebesky, Jindrich Prochazka, Vladimir Burda, Bela Kolářová, Emil Juliš, Josef Honys ou Jiří Valoch, une véritable « pléiade » des poètes concrétistes tchèques -, relève bien entendu de la même inspiration). Dans la poésie contemporaine ? Le courant d’explorations de formes radicalement nouvelles du jeu poétique semble interrompu, la plupart des choses qu’on nous propose de lire ou d’écouter semblent écrites par des gens totalement incultes, qui croient faire une révolution en ne mettant pas de ponctuation, mais il y a au moins une exception, et de taille : Valère Novarina (né en 1947, à Genève) écrit des pièces et des « textes » où surgissent constamment des personnages définis par des noms parfaitement invraisemblables qui tiennent des discours imprononçables ailleurs que dans l’espace du théâtre, des discours relatifs à des questions indissociablement méta- et pataphysiques, derrière lesquels on entrevoit très lointainement des mystères très fondamentaux (Le drame de la vie, 1984, ne comporte pas moins de 2587 personnages – dont par exemple Plongeon, Le Père Dedans, Dunlop, l’Enfant de Pantalon Joie, l’Homme de Fin, l’Acteur du Monde, l’Enfant Moteur, le Musicien du Bas, le Monstre de l’Hôpital Logique, le Sarcophrier Robert, Adam Dernier, Portion du Chef, l’Animal Vénérien, le Docteur Mâchefesse, le Cycloniste, la Personne Affaissée, Jean Cerveau, l’Angiste, l’Animal du Temps, l’Enfant de Plus Rien, le Chanceur Camion – et commence par l’entrée en scène d’Adam qui demande « D’où vient qu’on parle ? Que la viande s’exprime ? »). Et toute cette verve burlesque est incroyablement drôle et sidérante, on va d’incroyable en incroyable sans jamais redescendre dans le « vraisemblable », et, chose beaucoup plus remarquable encore, on peut voir représenter de telles pièces, qui durent souvent plus de deux heures, sans s’ennuyer (ou très peu).
Dada : aaaa baba caca eaea fafa gaga haha iaia jaja kaka lala mama nana oaoa papa qaqa rara sasa tata uaua vava wawa xaxa yaya zaza (poème transnational)
Atomistes grecs : l’étude minutieuse de fragments récemment retrouvés des philosophes présocratiques nous permet d’avancer sans le moindre reste de doute cette vérité difficilement supportable : Thalès, Anaximandre, Héraclite, Empédocle, Pythagore, Anaxagore, Démocrite et les autres « physiciens » de cette époque reculée, malgré ou peut-être à cause de la relative « modernité » de leurs idées, avaient horreur des peintures d’Igor Minárik. Pensez, l’irrationalité de (racine de) 2 les rendait déjà malades, alors un peintre qui se vautre comme ça, sans aucune retenue, dans de l’irrationnel à la puissance n, et qui n’est même pas mathématicien ! Eux font tout pour réduire la diversité des apparences à un ou deux principes et éléments fondamentaux, et ce petit barbare slovaque qui ne se souvient même pas de ses vies antérieures et qui sabote leurs efforts héroïques en donnant des arguments – qui n’ont même pas une forme philosophique correcte – à l’idée de bonne femme de la complexité irréductible de la réalité !
Élémentarisme : d’où vient ce qu’on peut nommer « l’élémentarisme » d’Igor Minárik, cette manière qu’il a toujours de procéder par addition de composantes relativement indépendantes ? Dans un essai extraordinairement pénétrant et dense, écrit il y a plus de vingt ans déjà, Rudolf Fila suggérait une origine philosophique («en accord avec la science la plus moderne (et qu’en est-il des atomistes grecs ?), il croît que c’est justement par les particules les plus petites que le monde est mis en mouvement »), mais il me semble que sur ce point, très exceptionnellement, il se trompait (comme il était alors interdit de faire la moindre allusion à des considérations religieuses, cette « erreur » était très probablement une astuce pour marquer immédiatement le sérieux « noétique » d’une œuvre qui, aujourd’hui encore, pourrait passer aux yeux d’observateurs superficiels pour uniquement formelle) : I. M. n’imagine au soubassement du monde pas plus des puces que des éléphants car il ne s’est jamais posé une telle question, infiniment trop rationnelle et rationaliste pour lui. Il arrive que des physiciens (dont certains tout à fait éminents dans leur partie) s’intéressent à ses tableaux, et il en est ravi, mais lui ne s’intéresse pas à la physique (à la différence par exemple de Rudo Sikora, Daniel Fischer ou, plus encore, Ilja Zelienka), et avoue sans difficulté qu’il n’y comprend rien. Alors ? Si son élémentarisme n’est pas une affaire de conviction, à quoi tient-il ? Réponse : au démon de l’agglutination. Il me semble que les parentés frappantes des dessins-peintures d’Igor Minárik avec les œuvres de certains « schizophrènes » comme avec celles de Duchamp, Dubuffet, Michaux, Kolář, Arman, Spoerri, Cragg ou Laubert, ne peut venir que d’une communauté de « tournure d’esprit », qui oblige à constituer les formes non par contour, de l’extérieur, mais de l’intérieur, par addition d’éléments. Une sorte de maladie, donc, qu’il faudrait ajouter à la nomenclature psychanalytico-psychiatrique, sous le nom par exemple d’agglutinisme » (c’est très laid, donc ça devrait marcher), et qui s’accompagne d’un notable déficit de grandes vues synthétiques, panoramiques, mais il ne faudrait pas oublier de préciser qu’on lui doit sans doute des formations naturelles, comme les récifs de corail, des langues entières, comme le hongrois, ou certains des plus grands livres jamais écrits, comme les Essais de Montaigne, le Tristram Shandy de Sterne ou La recherche … de Proust.
Complexificateur : la nature d’Igor Minárik a horreur de la simplicité (et du vide comme manifestation de simplicité). Dans l’aventure qu’est la réalisation de chaque tableau, il s’impose des contraintes qui excluent toute éventuelle tentation simpliste. La plus constante est la contrainte de non répétition : chaque élément* ne doit intervenir qu’une fois. Une autre, fréquente, est la contrainte de contraste maximal entre deux éléments voisins, mais elle est assez souvent relayée par la contrainte contraire de contrastes minimaux, faire quelque chose tout en nuances.
Arlequin suisse : les tableaux d’I. M. sont des manteaux d’un Arlequin snob, qui s’habillerait de patchworks de pièces colorées beaucoup moins simples que celles dont se contentent la plupart des tempéraments facétieux qui se promènent dans la Commedia dell’arte, un Arlequin devenu aristocrate, et abandonnant de ce fait la vulgarité des couleurs criardes à ses ancêtres. Un Arlequin qui casse ses couleurs, les neutralise, pour faire des polychromies neuves, plus diverses et, paradoxalement, beaucoup plus intenses. – Comment arrive-t’on à neutraliser les couleurs sans les éteindre ? – eh bien, très simplement (pour qui en a la patience) : en jouant des complémentaires, en associant des couleurs de même valeur, en alternant des sombres et des claires, des chaudes et des froides, des concaves et des convexes, des stridentes et des sourdes, … Et cet Arlequin fils (ou, plus sûrement, arrière arrière arrière petit-fils) est tellement raffiné (retors ?) que certains tableaux ont, de loin, l’air de camaïeux de bleu outremer, et apparaissent au regard rapproché non moins bigarrés que ceux, largement majoritaires, qui affichent leur polychromie.
Microbes : « Il y a des microbes gais qui engendrent des maladies terribles ; /…/ Il y a des microbes lents, réfléchis, méfiants, avec des allures de panthère /…/ Il y a des microbes qui rappellent le phoque ; d’autres semblent de joyeux géomètres qui sillonnent les eaux en navigateurs consommés ; il y a des microbes-cyclistes ; il y en a même qui ont l’allure de gens en promenade. Quelle énorme fourmillière ! Quelles interminables caravanes ! » (Ramon Gomez de la Serna : Le Docteur invraisemblable).
Hétérogénéité : les textures élémentaires dont I. M. compose ses tableaux sont hétérogènes, et même maximalement hétérogènes, mais de deux manières qui semblent opposées : – soit les différences sont éclatantes, chaque composante est absolument différente des composants voisins et de tous ceux qui remplissent la surface – soit les différences sont discrètes, minimes fines, camouflées, et on a des tableaux à dominante sombre dans lesquels on distingue mal les composantes.
Juxtaposer : dans la syntaxe Minárikienne, la préposition de loin la plus fréquente est « à côté de ». Il compose en juxtaposant. De là, comme pour les tableaux de Klee, une difficulté de perception adéquate, car nous appréhendons en un instant, immédiatement, ce qui est issu d’un processus de composition très long et patient.
Polyphrène : Stanislav Lec remarquait que la schizophrénie était une maladie terriblement nocive en ce qu’elle réduisait la riche pluralité psychique à l’opposition manichéenne de deux personnalités (« La division du moi est une grave maladie psychique, dans la mesure où elle réduit à une misérable dualité l’éclatement normal de l’homme en une infinie quantité d’êtres. ») I. M. est bien conscient de la parenté de ce qu’il fait avec les compositions maniaquement détaillées que dessinent ou peignent certains « schizophrènes », mais chez lui en tout cas ce « détaillisme » va avec une exaltation de la multiplicité psychique qui devrait tous nous faire rougir des simplifications que nous imposons à nos vies (réelles imaginaires).
Art brut : en France, où Dubuffet (1900-1987) a vécu et montré magnifiquement, tant par ses œuvres que par ses écrits, ce que l’art savant avait à gagner à oublier son savoir et à se nourrir de l’exemple des artistes sans culture, le fossé qui sépare les « travaux » de ceux qui sont passés par les Écoles d’art et les enfantillages magiques de « l’art brut » s’est à nouveau creusé : on ne peut voir les œuvres des bricoleurs plus ou moins fous qui se fichent des –ismes et des modes artistiques que dans des lieux à part, extérieurs aux circuits des galeries et des musées, qui n’acceptent, le cas échéant (et il y a, heureusement, des exemples, comme Tony Cragg, Gilles Barbier, Olivier Blanckart, Richard Fauguet, Michel Blazy, …) que ce qu’on doit bien se résoudre à nommer « l’art brut cultivé ». Dans la Tchécoslovaquie communiste où Igor Minárik a vécu ses 44 premières années, l’art des artistes diplômés qui ne se conformaient pas à « l’esthétique » des apparatchiks au pouvoir ne pouvait pas être montré, ou seulement dans des lieux très marginaux, mais il était encore plus difficile de montrer ce que faisaient des artistes sans formation, comme Ji í Kolář, Ladislav Novák ou Otis Laubert, dont beaucoup d’artistes professionnels admettaient d’autant moins l’existence et la valeur qu’ils n’en reconnaissaient pas la possibilité. Ce n’était que d’une manière clandestine que l’on pouvait s’intéresser à l’art brut (des membres du groupe surréaliste comme Alena Nádvorníková ou Jan et Eva Švankmajer en ont rassemblé dès cette époque des collections importantes), et un artiste passé par le moule des Beaux Arts qui décidait de faire table rase de ce qu’il avait appris et de se lancer dans l’inconnu trahissait le camp de l’Art admirable, commettait un véritable suicide social. Le terme « art brut » fait désormais partie du lexique de l’art du XXème siècle, et dans les républiques slovaque et tchèque qui ont succédé à la Tchécoslovaquie il y a eu de grandes expositions tant d’art brut naïf que de cet art brut paradoxalement savant que font certains des artistes ayant commencé leur parcours original après Dubuffet, mais on oublie que le choix de l’exploration de matières et de procédés rejetés par le « bon goût », joint au renoncement à la maîtrise artistique acquise, exposait à une sorte de malédiction sociale et demandait donc beaucoup de courage. Dans le nouveau contexte politique et esthétique, ceux qui croient savoir à quoi doit ressembler l’art véritable sont toujours moins nombreux, il n’y a donc plus d’artiste maudit, mais du coup plus personne n’a conscience de l’enjeu de nouveauté absolue qu’avait pour Dubuffet la quête passionnée de l’art brut, et qu’a pour ses admirateurs et continuateurs, dont Igor Minárik, la quête d’un art brut au delà du savoir faire.
Enfance de l’art : du point de vue technique, les tableaux d’Igor Minárik pourraient être peints par n’importe qui (même les enfants de quatre ans qui ont un peu de mal à égaler Picasso, sauf qu’ils n’en auraient jamais la patience, la sûreté de geste ni bien sûr l’idée), ils ne demandent pas un talent exceptionnel : chaque élément * résulte de gestes picturaux extrêmement simples, à la portée de tous, c’est seulement la répétition, la diversification et la localisation de ces gestes qui demande des démarches hors du commun. Lautréamont-Ducasse affirmait que « La poésie doit être faite par tous et non par un », et comme tous les artistes qui depuis plus d’un siècle ont révolutionné l’art en revenant à ses sources les plus profondes et les plus universelles, I. M. a pris au sérieux cet appel que la moindre conscience des exigences constitutives de l’Art interdit de prendre au sérieux, et il a dores et déjà donné de très nombreuses solutions à l’insoluble problème d’œuvres à la fois uniques et à la portée de tous.
Enfants : I. M. conçoit l’enseignement artistique (qui est son occupation professionnelle) comme initiation à un savoir faire par l’intermédiaire de jeux-défis, qui passent par la peinture et débouchent sur des « œuvres ». Ainsi : faire une tête de deux manières différentes, par exemple par dessin et par collage, avec des fonds maximalement contrastés ; dessiner un personnage qui court en positif et en négatif ; faire partir un labyrinthe d’un trait d’un visage et le développer jusqu’à ce qu’il le recouvre complètement ; faire un damier où aucune couleur ne se répète ; dessiner un jardin à partir de photos montrées juste avant ; dessiner un arbre de toutes les couleurs ; dessiner un personnage et un arbre qui le cache partiellement ; faire sortir d’une hotte quelque chose de très surprenant ; imaginer les entours d’une photographie ;
Humour : prendre à contre-pied les attentes ordinaires des gens « normaux », qui proportionnent leur intérêt à la valeur généralement reconnue des objets, accorder toute son attention aux éléments « les plus insignifiants » (Rudolf Fila) est une démarche paradoxale et typiquement humoristique. En tant que personne, et malgré son goût prononcé pour les longues promenades solitaires dans la Nature ou les longs séjours dans son atelier, Igor Minárik est sociable et jovial, quelqu’un qui rit volontiers et cherche toujours les aspects inattendus et amusants des situations, mais ses œuvres aussi ont de l’humour, elles sont même humoristiques dans leur principe. Ce qui ne veut pas dire qu’elles sont destinées à faire rire (heureusement, car il faudrait les considérer comme des échecs), mais qu’elles reposent sur le déplacement systématique des conceptions, des solutions ou des évaluations communes (On pourrait faire la même remarque à propos des œuvres de Josef Váchal, Jiří Koláŕ, Ladislav Novák, Dalibor Chatrný, Rudolf Fila, Kurt Gebauer, Otis Laubert, Dezider Tóth, Milan Bočkay, Klára Bočkayová, Vladimir Kordoš, Matej Krén, Vladimír Kokolia, František Skála, Dorota Sadovská … – pour ne citer que des artistes slovaques ou tchèques -, et constater que ce sont comme par hasard celles qui « se » sont le plus souvent et le plus radicalement renouvelées).
Joie : dans notre culture du divertissement (en anglo-américain «entertainment »), où la neuvième symphonie de Beethoven est devenue l’hymne européen, le mot « joie » est passablement galvaudé, mais je ne pense pas qu’il y en ait d’autre pour dire une qualité omniprésente de ce que peint Igor Minárik. Il perçoit certains tableaux comme plus joueurs, inattendus ou même humoristiques que d’autres, il fait également des différences d’enjouement ou de tristesse (en proportion assez directe de la prédominance d’éléments clairs ou sombres), mais en deçà de ces différences (que certains ne perçoivent pas), tous ses tableaux irradient comme une énergie lumineuse ce sentiment d’allégresse et de plénitude enfantines : joie de la pure création, joie de l’abondance d’invention, joie que procurent et amplifient les couleurs harmonisées, joie d’oser et de réussir quelque chose qui n’a jamais été tenté par personne, joie orgueilleuse de celui qui réussit à justifier un paradoxe. I. M. n’est pas lyrique, au sens des auto-dissections de sentiments devant le monde entier, mais il l’est très profondément et essentiellement au sens où l’on a pu qualifier de lyrique la prose de Giono dans « Le chant du monde », au sens de l’art de parler pour dire qu’on ne peut pas dire ce dont la merveille excède tous les mots, et ce faisant le dire.
Micromacrocosme : chaque tableau d’I. M. est un microcosme de microcosmes ou, plus exactement, un microacosme de microacosmes, car ni la totalité du tableau ni celle des « éléments » ne sont à proprement parler des « cosmos », des mondes organiquement organisés, comme tout être vivant. Peut-être faudrait-il dire plutôt micro-univers de micro-univers, si l’on veut bien différencier de l’antique notion de cosmos (forgée, dit-on, par Pythagore) la notion moderne d’Univers (infini, régi par des lois mécaniques inintelligentes).
Lenteur : c’est une œuvre née dans un pays où des artistes d’esprit moderne associent encore l’art à la lenteur (l’art est traditionnellement une affaire lente, qui demande énormément de patience ; les modernes, de multiples façons, ont introduit une exigence contradictoire de rapidité ; les « contemporains », souvent, ont sacrifié les exigences traditionnelles aux exigences spécifiquement modernes, en se persuadant quelquefois que les techniques productrices de « readymades », notamment photographiques ou numériques, pouvaient fournir un substitut acceptable aux lenteurs artisanales, et les œuvres qui sortent de telles simplifications manquent en général de ces qualités qui pourraient susciter un intérêt durable ; Igor Minárik, comme la plupart de ses amis du groupe A/R, reste dans la féconde contradiction de l’art moderne, à une époque où l’absence d’art de ce qu’on persiste à nommer « art contemporain » devient la règle).
Eva : Madone gothique (rebaptisée à la Renaissance) dont il a trouvé dans la vie une copie acceptable, qui a bien voulu l’épouser (ce qui est une manière très radicale de rapprocher l’art de la vie). Artiste elle-aussi (pas la madone, un peu d’attention, svp), elle pratique et enseigne de manière remarquablement créative la tapisserie, c’est-à-dire un art traditionnel, très ancien, presque toujours considéré comme une affaire d’exécution. La peinture telle que la conçoit I. M. laisse une place essentielle à l’invention et à l’improvisation, mais n’exclut pas moins que la tapisserie toute expression gestuelle, absolument spontanée, et demande également qu’on lui consacre énormément de temps et de patience. Dans un monde où tout le monde doit et veut aller toujours plus vite, tous deux s’offrent le luxe, discrètement insolent, de la lenteur.
